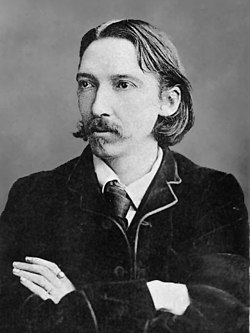0 avis
PSYCHOMÉCANIQUE, linguistique
Article
Edité par Encyclopædia Universalis - 2018
Le nom de « psychomécanique » (ou encore « psychosystématique ») du langage a été donné à la théorie développée dans la première moitié du XXe siècle par le linguiste français Gustave Guillaume (1883-1960), dont les écrits sont rassemblés dans deux recueils posthumes d'articles (Langage et science du langage, 1964 ; Principes de linguistique théorique, 1973) et une série de volumes de Leçons (conférences données à l'École pratique des hautes études entre 1944 et la fin des années 1950).Profondément originale, cette théorie d'inspiration structuraliste considère le système de la langue comme une abstraction résultant d'une construction intellectuelle, et non pas (à la manière des distributionnalistes) comme un donné immédiatement accessible à l'observation. Pour Guillaume, la question centrale est celle des rapports entre formes et sens : il s'agit de caractériser les opérations de pensée constitutives des signifiés que l'on peut reconstruire à partir des formes. La spécificité de l'approche psychomécanique réside dans la façon dont elle inscrit la pensée dans le langage. Elle postule en effet que, pour les besoins de l'expression linguistique, la pensée (qui est en soi un flux continu) doit opérer en elle-même deux séries de « coupes » : l'une sur le plan de la langue, l'autre sur le plan du discours.La série de coupes opérant au niveau de la langue permet à la pensée de délimiter en elle-même certains grands mouvements : par exemple le mouvement allant de l'universel au singulier, qui a valeur de schème explicatif très fécond pour de nombreux sous-systèmes de la langue (notamment pour décrire le système des déterminants, ou encore celui des temps et des aspects – domaines d'étude privilégiés de Guillaume). La langue n'est donc pas définie comme un inventaire d'éléments, mais comme un ensemble de schémas dynamiques, de « cinétismes ». La seconde série de coupes, qui opère cette fois au niveau du discours, consiste à intercepter un mouvement caractérisé en langue, de façon à le découper en parties fixes. Cette interception se fait, selon les cas, plus ou moins près de l'origine sur l'axe du mouvement ; le caractère précoce ou tardif de cette coupe confère alors au signe une valeur particulière, liée à son emploi en contexte.Cette démarche peut être illustrée par l'un des exemples favoris de Guillaume, celui de l'article. En langue, l'article « un » correspond à une tension cinétique de l'universel au singulier. En discours, une interception précoce de cette tension livrera une valeur généralisante de l'article (« Un enfant est toujours l'ouvrage de sa mère »), alors qu'une interception tardive livrera une valeur particularisante (« Un enfant entra »). De son côté, l'article « le » correspond en langue au mouvement inverse, progressant du singulier à l'universel. En discours, une coupe précoce construira donc une valeur particularisante (« L'homme entra »), tandis qu'une coupe tardive construira une valeur généralisante (« L'homme est mortel »). Ainsi
Consulter en ligne
En savoir plus
Biographie